Une agression à Toulouse met en évidence la transphobie banalisée de la police et des médias
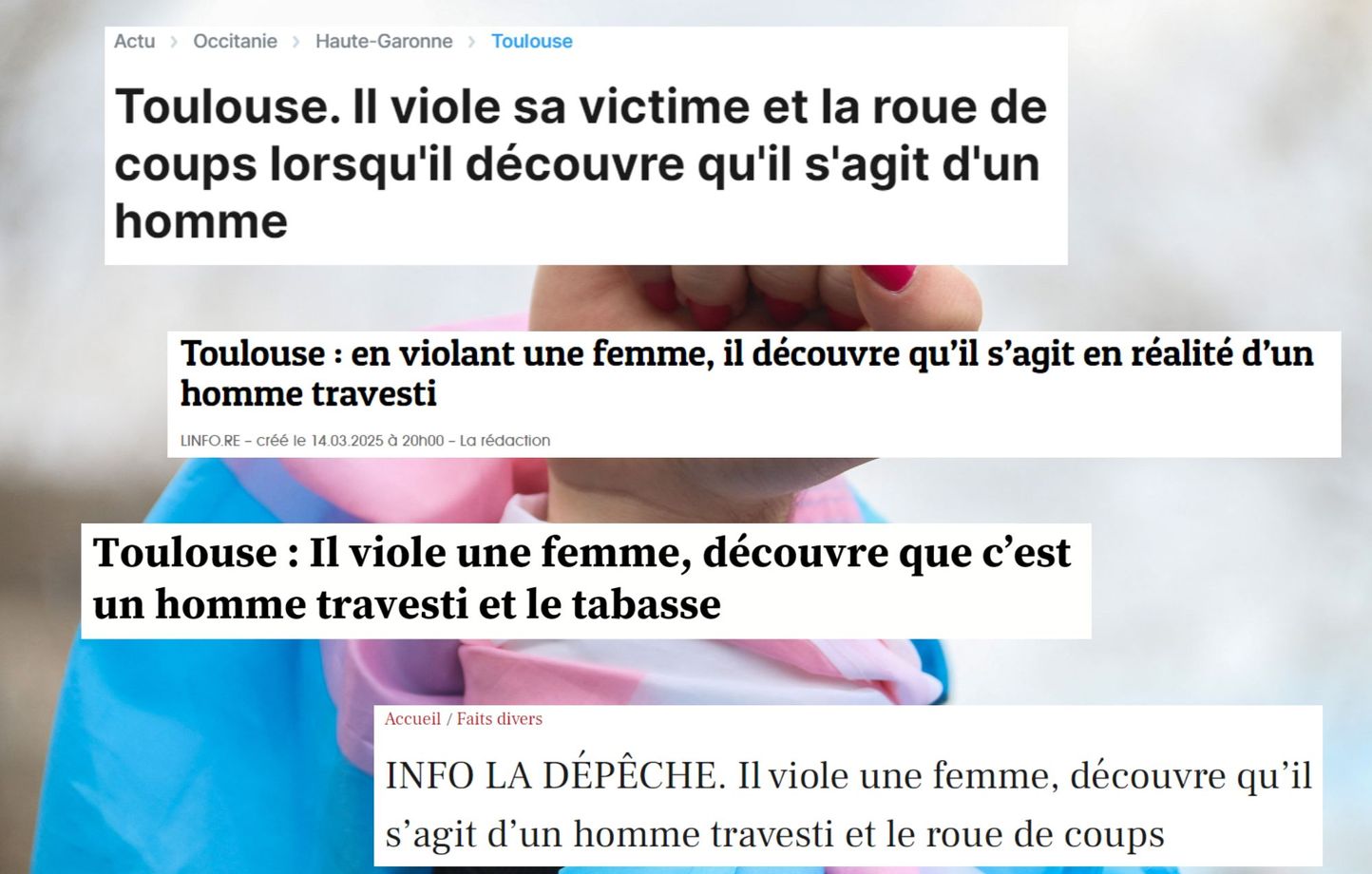
Jeudi 13 mars, cinq jours après les faits, le récit d’un viol et d’une agression physique à Toulouse fait le tour des médias. La plupart, y compris 20 Minutes, reprennent la même tournure de phrase sensationnaliste, le plus souvent dans le titre : « il découvre que c’est un homme travesti et le roue de coups ». Une manière de ne pas clairement parler d’un acte transphobe, qui pose problème à plusieurs égards.
D’abord, parce que cela révèle un manque de recul des journalistes vis-à-vis de leurs sources. « Lorsqu’une femme trans est désignée comme un homme travesti, c’est souvent un élément de langage des forces de l’ordre », bien souvent seule source des journalistes dans ce genre de cas, pointe Niléane, porte-parole de l’association Toutes des femmes. « La police ne réfléchit qu’en termes d’état-civil », donc si une femme transgenre n’a pas fait de changement administratif, « ils vont la considérer comme un homme », explique Coline Folliot, coprésidente de l’Association des Journalistes LGBT + (AJL).
« L’état-civil du plaignant est vérifié à l’aide d’un document d’identité », justifie de son côté le service de communication de la police (Sicop), joint par 20 Minutes. « L’accueil de la personne transgenre s’effectue tout d’abord selon son apparence. Toutefois, il convient de prendre en compte le genre selon lequel la personne accueillie se définit, ce choix est respecté en utilisant la civilité et le prénom indiqués par la personne, y compris au sein des procès verbaux établis. Dans la rubrique « identité », il convient de faire apparaître à la fois le genre et l’identité figurant sur les documents officiels présentés et ceux d’usage. »
Entre la police et les personnes trans, « il y a un passif »
« Même en étant bien intentionnés, les journalistes ne se posent pas assez la question. Dire « c’est peut-être une femme trans » mais titrer sur le travesti, ce n’est pas assez », juge Coline Folliot. Il était pourtant possible de se passer du terme « travesti », poursuit-elle. Même sans s’avancer sur le genre de la victime, « il est clair que c’est un acte transphobe », reprend-elle, puisque les coups ont commencé lorsque l’agresseur a découvert le sexe de la personne qu’il assimilait à une femme cisgenre. Mais surtout, la frilosité des médias à évoquer la transidentité d’une victime, même lorsque le déroulé de l’agression correspond à un acte transphobe, est d’autant plus coupable qu’« on ne peut pas exclure que les sources policières fassent preuve de transphobie ». « L’impartialité […] dont les policiers doivent faire preuve fait l’objet d’attentions particulières, prenant en compte les évolutions sociétales, comme plus récemment le mariage pour tous et le combat LGBTQI+ », admet le Sicop, insistant sur le renforcement du nombre de référents sur la question en commissariat.
Entre la police et les personnes trans, « il y a un passif qui n’est pas négligeable », souligne justement Anaïs Perrin-Prevèle, directrice d’OUTrans. « On ne compte plus les personnes trans arrêtées lors des manifestations pour nos droits, qui reçoivent des propos déplacés » de la part des policiers, voire pire. Si bien que lorsqu’elles sont victimes d’agressions, peu de personnes trans osent porter plainte, encore moins en s’outant devant les forces de l’ordre, « puisque l’endroit où on porte plainte est un endroit où on peut aussi être discriminé ». Dans le cas de l’agression à Toulouse, la police et le parquet ont maintenu que le victime était « un homme travesti ». Le Sicop rappelle de son côté que « les informations personnelles d’une victime ou d’un mis en cause n’ont pas à être transmises à la presse ». Ce qui fait revenir le problème à la transmission du seul état-civil.
Le mégenrage, une violence supplémentaire
Reprendre sans interroger les informations policières représente dès lors un clair risque de mégenrage de la victime, une violence supplémentaire pour elle comme pour les autres personnes trans. Mais ce n’est pas tout. En titrant sur la découverte du « travestissement » de la victime, les médias tombent « dans un stéréotype transphobe classique » qui vient « justifier l’agression, lui trouver une circonstance atténuante », dénonce Coline Folliot. Le mécanisme de « trans panic defense » est un élément couramment utilisé par les agresseurs pour expliquer leur passage à l’acte, en raison d’un effet de surprise, voire d’un « choc » à la découverte du pénis de la femme qu’ils sont en fait en train de violer.
La justification n’est guère plus glorieuse côté médias. La machine de l’information incitant à reprendre les titres qui marchent ailleurs, plusieurs médias ont repris la même tournure de phrase. Or, même sans vouloir excuser l’agresseur, « titrer sur ce ressort d’une histoire glauque mais un peu marrante, insolite, contribue à renverser la perspective » et à ne pas faire de la personne trans « une bonne victime », prolonge la coprésidente de l’AJL. Pire, lorsque la victime est une travailleuse du sexe, « souvent on tait la situation de précarité, à la place on a une désignation humiliante », ajoute Niléane. Mégenrage, emploi de l’ancien prénom, sensationnalisme… Les médias avaient ainsi multiplié les traitements problématiques lors du meurtre de Vanesa Campos en 2018, puis lors du meurtre d’un « homme travesti » à Reims en 2021.
La transidentité, une réalité aux multiples facettes
Se référer uniquement à l’état-civil ou parler « d’homme travesti » traduit aussi une ignorance encore large sur la question de la transidentité. Si Emmanuel Macron juge « ubuesque » les propositions visant à permettre de « changer de sexe en mairie », les démarches pour faire changer ne serait-ce que son prénom sur une carte d’identité sont longues, complexes, et nécessitent d’avoir déjà un vécu social sous ce nouveau prénom. « On est sur une période de bascule sur les questions de transidentité », estime Anaïs Perrin-Prevèle, citant que « la dépsychiatrisation à l’OMS ne date que de 2022 ». Jusqu’en 2016, la loi française imposait la stérilisation et la chirurgie de réassignation sexuelle pour changer d’état-civil. Or, toutes les personnes trans ne souhaitent pas recourir à la chirurgie, et cette dernière n’intervient généralement qu’après un long parcours personnel.
Tous nos articles sur la transidentité
« Il faut arrêter de penser que la transidentité est un sujet de débat », alors que les personnes trans ont toujours existé, clame-t-elle. Mais « le grand public a une vision très réduite » et caricaturale, d’autant que lorsque le sujet tombe sur les plateaux télés, les personnes trans sont rarement invitées, contrairement aux transphobes. Les polémiques se concentrent sur des clichés sur les femmes trans, quand « la réalité des transidentités est très large », affirme la directrice d’OUTrans. Il reste du chemin avant d’avoir un traitement correct dans les médias et des droits décents pour les personnes trans.


