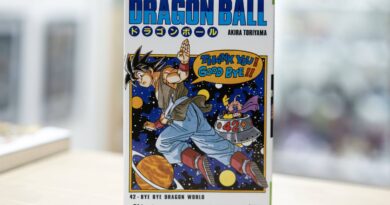« Le techno-féodalisme était une hypothèse, avec le tandem Trump-Musk, on a sa réalisation »

La révolution du numérique, tant annoncée, est assurément là. Et comme toute révolution digne de ce nom s’accompagne d’un changement de régime, l’économiste français Cédric Durand, enseignant à l’université de Genève, a trouvé dès 2020 un terme pour qualifier cette nouvelle ère : le techno-féodalisme.
Un concept qui a trouvé de l’écho puisqu’il a été repris depuis par des personnalités de tous bords, de l’économiste et ancien chef du gouvernement grec Yanis Varoufakis à Steve Bannon, l’ex-allié et stratège de Donald Trump lors de son premier mandat. Pour comprendre les nouvelles réalités que recouvre ce terme, 20 Minutes a interviewé son concepteur.
Pouvez-vous revenir sur l’origine du terme « techno-féodalisme » ?
A partir du milieu des années 2010, il y a eu un changement d’ambiance dans la perception de la tech par rapport à la période précédente. Jusqu’alors, c’était très enthousiasmant, de façon presque unanime. Pendant les révolutions arabes, par exemple, on voyait Facebook comme un des éléments de libération, de démocratisation… que des choses extrêmement positives.
Peu après, on a commencé à se rendre compte que ces sympathiques start-up étaient en train de devenir de féroces monopoles. Et que leur capacité à centraliser des richesses, à contrôler des informations, à manipuler le débat public inquiète.
La notion de techno-féodalisme vient de l’imaginaire cyberpunk, les jeux de rôle des années 1980. C’est intéressant car la généalogie critique de ces mégas-corporations technologiques remonte aux origines même de ce mouvement numérique. Alors que ce qui dominait était un optimisme naïf, certains avaient pressenti le danger.
Le terme suggère l’existence de serfs, de terres, de seigneurs, de vassaux. Alors, qui est qui ?
Les terres seraient les technologies dominantes autour du numérique dont nous sommes de plus en plus dépendants. Les seigneurs sont ceux qui possèdent ces technologies – les grands génériques, les GAFAM, ceux qui contrôlent les tuyaux, les données, les clouds et les services fondamentaux associés.
Et autour, il y a tout une série de vassaux spécialisés dans un domaine, avec une certaine autonomie. On peut penser à Mercadolibre, une espèce d’Amazon pour l’Amérique latine, le grand industriel européen Siemens ou même la SNCF. Tous opèrent des données en masse mais en dernier ressort ils dépendent de cloud de Google, Microsoft ou Amazon. Donc on retrouve aussi ce mécanisme de noble de second rang.
Et les serfs, ce sont nous, les personnes ordinaires, les entreprises de moindre taille et une grande partie de administrations publiques États. Nous sommes toujours plus soumis à ces technologies au quotidien et ceux qui les contrôlent prélèvent une part croissante de notre revenu.
Comment cela se traduit-il concrètement ?
Par l’automatisation des relations sociales, du travail intellectuel. Insistons d’abord sur les différences [avec un système féodal traditionnel]. La principale est que les serfs travaillaient de façon individuelle : ils avaient leurs propres outils, faisaient leur travail et payaient aux seigneurs un supplément en nature et en corvée. Aujourd’hui, le travail est socialisé. Même si on est sur son vélo seul en train de travailler pour une plateforme, on est lié aux autres.
Ce qui est frappant, par contre, c’est la fusion du politique et de l’économique. Aujourd’hui, les plus grands capitaux sont associés à des entreprises de technologie de l’information. Et ces entreprises organisent notre vie collective, le débat public – on le voit avec les réseaux sociaux. Elles régissent aussi la façon dont on circule – pensez à Google Maps.
Et dans cette fusion du politique et de l’économique, il y a quelque chose de très réminiscent avec le féodalisme. Les seigneurs étaient à la fois des maîtres politiques – ils rendaient justice – et des maîtres économiques – ils prélevaient le surplus. Cette caractéristique va de pair des inégalités extrêmes, une forme de centralisation extrême de la richesse que l’on retrouve aujourd’hui.
Votre livre date de 2020. Quelle réactualisation du concept pouvez-vous faire ?
Le techno-féodalisme était une hypothèse. Aujourd’hui, avec l’arrivée au pouvoir du tandem Trump-Musk, on a une réalisation de ce projet. Un moment de fusion du pouvoir de la tech et du politique. On pourrait même dire une tentative de désarticulation du pouvoir américain pour le remplacer par ce méga-pouvoir des corporations de la technologie.
L’arrivée de Trump et Musk a donné une formidable accélération à ce concept. On assiste à la soumission, à travers DOGE [Department of Government Efficiency], des administrations américaines aux outils des principales entreprises de la tech, avec dès les premiers décrets la levée de restrictions. Par exemple, les codes pour l’IA devaient être soumis à l’État américain s’ils constituaient un danger pour l’environnement, les travailleurs ou la sécurité nationale. Au premier jour, cette restriction a été levée. Ça va très, très vite.