Blue Monday : « La déprime du lundi matin est liée au capitalisme »
Nous sommes le troisième lundi du mois de janvier et comme l’a assuré une campagne publicitaire britannique pour une agence de voyages en 2005, nous nous apprêtons à vivre le « jour le plus déprimant de l’année », aussi appelé le « Blue Monday ». Si ce concept ne repose sur aucune assise scientifique, ce n’est pas un hasard s’il tombe un lundi. D’après une étude pour le site Monster, 61 % des citoyens et citoyennes du monde ont la phobie du lundi. Même le Guiness des Records a décrété que le lundi était « le pire jour de la semaine »… Mais alors, pourquoi ?
D’après Nicolas Framont, sociologue du travail, auteur de Vous ne détestez pas le lundi, vous détestez la domination au travail, sorti en octobre dernier aux éditions Les liens qui libèrent, ce sentiment est intimement lié à la souffrance au travail, elle-même induite par le système capitalisme.
Pourquoi le « Blue monday » est-il forcément tombé un lundi, selon vous ?
Au-delà de l’aspect marketing, ce concept bidon parle d’une expérience collective : nous sommes, en majorité, souvent déprimés le lundi. Si j’ai parlé du lundi matin dans mon livre, c’est justement parce qu’il m’a semblé que c’était un point de ralliement, une expérience à laquelle beaucoup de personnes pouvaient s’identifier. Mais en réalité, le problème, ce n’est pas le lundi. C’est de travailler sous le capitalisme.
Quel est le lien entre le capitalisme et la déprime du lundi ?
De ce que j’ai pu constater à travers mon expérience [Nicolas Framont était expert auprès des comités sociaux et économiques des entreprises], la déprime du lundi vient de la racine de ce qu’est de travailler sous le système du capitalisme, où l’on est dépossédé de toute une partie de notre travail. Le fruit de notre travail ne nous revient pas ou très peu. On en arrive à la fameuse formule du « à quoi bon ? ».
Si dans certains métiers, on peut être bien payés, dans d’autres, souvent moins bien qualifiés, on reçoit à peine de quoi survivre. On se dit alors : « Si on travaille pour se nourrir mais on se nourrit pour travailler, à quoi bon ? »
Mais à l’inverse du « Blue Monday », cette déprime et souffrance au travail ne durent pas qu’une petite période. Être mal au travail est intrinsèque au capitalisme et à comment les rapports économiques génèrent de la souffrance.
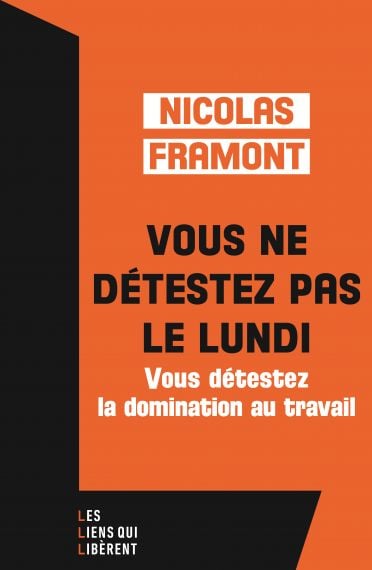
Comment le capitalisme génère-t-il de la souffrance au travail ?
Ce n’est pas un phénomène nouveau car le capitalisme existe depuis deux siècles mais on assiste, ces dix dernières années, à une montée de ce sentiment d’aliénation et de souffrance psychique au travail. D’abord, parce que le travail est devenu plus aliénant avec des organisations du travail [avec de plus en plus de hiérarchie] qui mettent beaucoup plus les gens sous pression, attendent plus de résultats, laissent beaucoup moins de répit et donnent moins d’autonomie aux travailleurs.
Puis, parce qu’il y a eu l’émergence de formes nouvelles d’aliénation psychiques. Désormais, on demande aux salariés d’être très impliqués, de faire corps avec l’esprit de l’entreprise et donc, de renoncer à sa propre identité. Conséquences ? On assiste à une augmentation des burn-out en France. Les études disent que c’est une personne sur deux qui se dit en détresse psychique à cause de son travail et pourtant, la loi ne le reconnaît pas comme maladie professionnelle, déresponsabilisant les employeurs. Cette statistique est énorme : on parle donc d’une expérience majoritaire. Et ça n’a pas toujours été comme ça. Il y a eu des phases où on était moins exposé, avec plus des capacités de résistance et donc de se plaindre, de faire grève, par exemple.
Donc, c’est tout ça, la déprime du lundi matin. Et malheureusement il n’y a pas que le lundi qui pose problème, sinon ce serait trop simple.
Dans votre livre, vous dites que cette souffrance est notamment due à la hiérarchie…
Oui et il faut la réduire ! Maintenant, il y en a partout, même dans des secteurs comme les associations ou la fonction publique, qui n’en étaient pas trop dotés. On voit donc apparaître des chefs à tous les niveaux, qui surveillent, qui contrôlent et qui infantilisent aussi, d’une certaine manière.
Je pense d’ailleurs que la souffrance du lundi matin peut être rapprochée à celle qu’on avait quand on était enfant, quand on ne voulait pas aller à l’école, lieu où on était soumis à des ordres, à une discipline et à des contraintes. Pour beaucoup, le monde du travail, c’est encore ça, malheureusement. Et cette infantilisation a des conséquences au-delà de notre profession. Moins on a d’autonomie au travail, moins on va prendre des initiatives dans la sphère publique. Si toute la journée on vous dit « c’est comme ça et pas autrement », il y a peu de chance que vous alliez pétitionner, voter et vouloir « changer les choses » car vous éprouvez ce même sentiment de, « de toute façon quoi que je fasse, ça ne change rien ».
Notre dossier Vie Pro
Comment changer cette dynamique pour finir par aimer le lundi matin ?
Peut-être que si on faisait un travail dont on récupérait les fruits, qu’on était libre de le faire comme on l’entend, avec des gens qu’on estime, sans recevoir d’ordres, peut-être qu’on aimerait bien le lundi matin. D’ailleurs, les gens qui me répondent qu’ils aiment le lundi matin – rares mais qui existent –, ce sont des travailleurs indépendants, qui voient vraiment comment leur travail paie et qui ont un sentiment de « possession » de leur travail.
Sinon, d’après les témoignages récoltés, ce qui empêche les employés de « sombrer », ce sont toujours les collègues. Entre collègues, on parle de nos problèmes de travail, on s’organise, on fait des petites réunions. C’est grâce à la force des collègues qu’on peut arriver à apprécier son lundi matin, c’est comme ça qu’on introduit de la joie au travail. Une vision qui est donc complètement à l’opposé de celle de la société capitaliste actuelle qui pousse à l’individualisme et à la concurrence.
D’ailleurs, on pense souvent, à tort, que faire grève est inutile. Pourtant, selon les chiffres du ministère du Travail, en 2021, 79 % des entreprises déclarant au moins une grève ont mis en place des accords favorables aux salariés, contre seulement 16,6 % des entreprises n’ayant connu ni grève ni conflit. En conclusion, demander les choses gentiment et individuellement, ça ne fonctionne pas. Le collectif reste ainsi quelque chose qui produit des résultats et qui peut vraiment changer la donne.


